Rectocolite hémorragique : une meilleure caractérisation des lymphocytes B lors de la pathologie
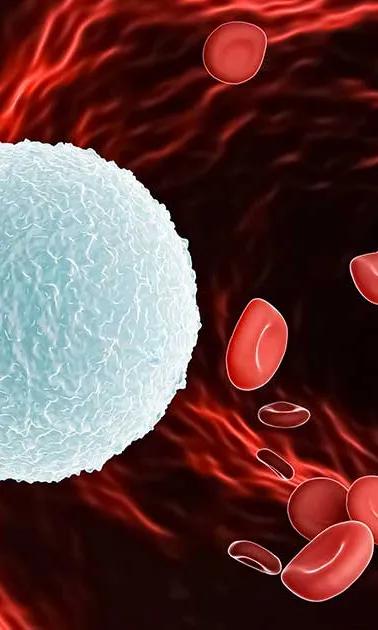
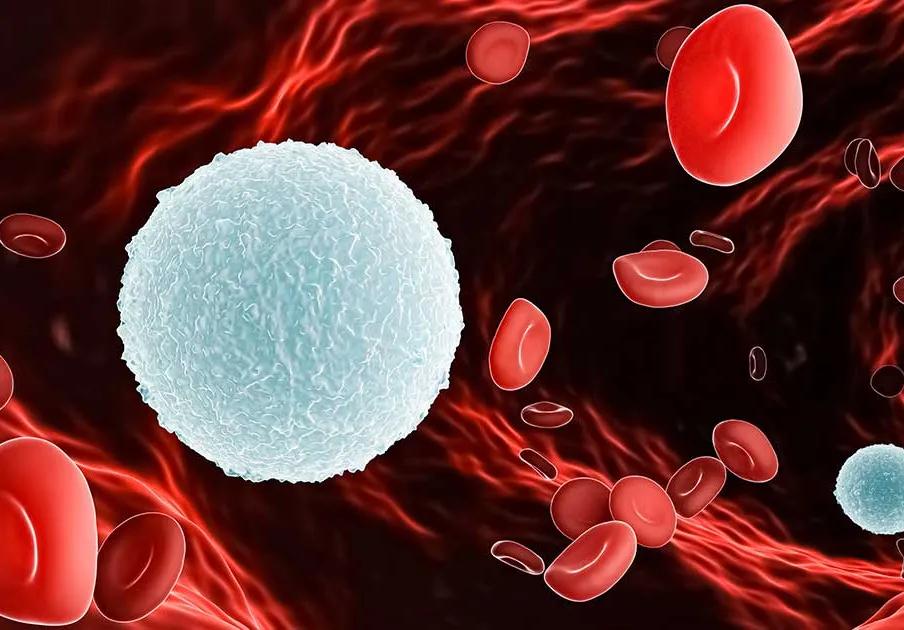


01 février 2015
01
Cette recherche est menée par Julien Royet, à la tête de l'équipe « Réponse immunitaire et développement chez la Drosophile » au sein de l'Institut de Biologie du Développement de Marseille-Luminy.
Financement accordé à Julien Royet, dont le projet a été sélectionné par le Conseil Scientifique de la FRM en 2014.
Les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin sont définies par une inflammation chronique au niveau du tube digestif provoquant des symptômes très invalidants.
Des recherches ont mis en évidence l'implication de la flore bactérienne intestinale dans l'apparition de ces pathologies.
Julien Royet et son équipe souhaitent comprendre les mécanismes moléculaires qui contrôlent cette flore bactérienne en vue de clarifier son implication dans la maladie.
02
Les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, ou MICI, sont des pathologies très invalidantes caractérisées par une inflammation de tube digestif évoluant par une alternance de poussées et de phases de rémission. Ces maladies, de plus en plus répandues en France et dans les pays occidentaux, sont actuellement prises en charge par des thérapies symptomatiques qui visent à réduire l'inflammation, sans pour autant s'attaquer à ses causes.
Julien Royet et son équipe s'intéressent à un paramètre qui pourrait s'avérer prépondérant dans l'apparition de ces pathologies : le microbiote intestinal, c'est-à-dire les bactéries de la flore digestive normale de l'organisme.
La population bactérienne hébergée par notre intestin est très importante : on y compte environ 100 000 milliards de bactéries (soit 100 fois plus que le nombre de cellules dont est constitué le corps humain), qui appartiennent à plusieurs centaines d'espèces différentes.
Il est aujourd'hui clairement établi que le microbiote intestinal possède des propriétés qui dépassent la simple aide à la digestion pour l'organisme. Il a la capacité de moduler le fonctionnement de notre système immunitaire, ou encore de réguler certaines activités du système nerveux : le microbiote intestinal est ainsi considéré par les chercheurs comme un véritable organe à part entière, dont les dysfonctionnements auraient de graves conséquences pour l'organisme.
Des dérèglements inopportuns du nombre de bactéries, de leur localisation dans le tube digestif ou encore de la proportion relative entre les différentes espèces induiraient une réaction immunitaire anormale au niveau de la paroi intestinale. Cette dernière pourrait être à l'origine de l'inflammation retrouvée dans les MICI.
Au cours de leur projet, Julien Royet et son équipe souhaitent étudier les mécanismes moléculaires mis en place par la paroi intestinale pour contrôler le nombre de bactéries intestinales, leur positionnement et leur répartition le long du tube digestif.
Leurs travaux seront menés sur un modèle animal, la mouche du vinaigre (ou drosophile) dont le système immunitaire est proche de celui des mammifères. Par des techniques de génétique avancées, les chercheurs provoqueront des mutations au sein de ces modèles au niveau de gènes servant notamment à la reconnaissance des bactéries par les cellules de la paroi intestinale. Ils observeront le retentissement de ces mutations sur la réponse immunitaire intestinale, mais également au niveau du microbiote intestinal.
Explorer les régulations existantes entre le microbiote intestinal et l'organisme pourrait ouvrir de nouvelles stratégies de prise en charge des MICI, et donc de développer de nouveaux traitements pour ces pathologies.
03
Rectocolite hémorragique : une meilleure caractérisation des lymphocytes B lors de la pathologie
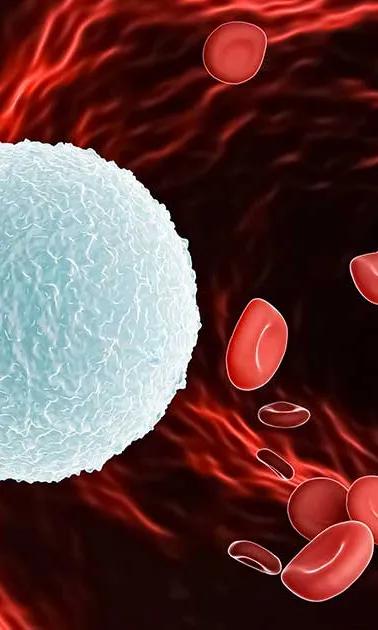
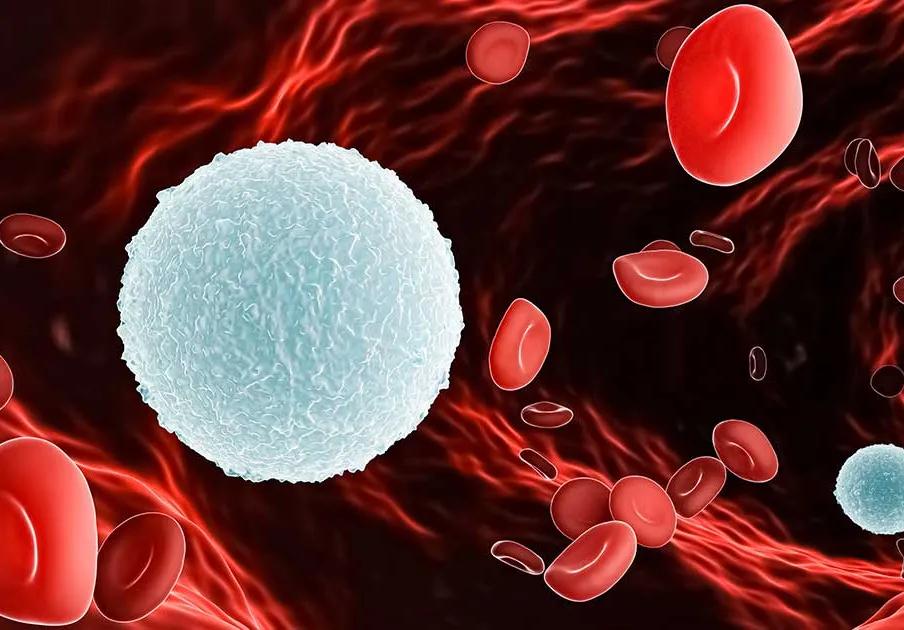
MICI : moduler l’action du microbiote pour réduire l’inflammation intestinale
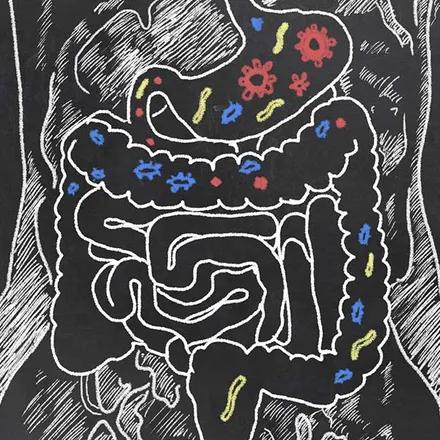
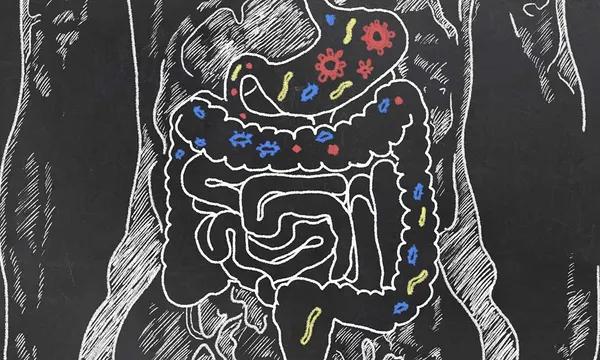
MICI : une meilleure compréhension des mécanismes prédisposant à ces pathologies




Maladies rares

Science ouverte
Découvrez les publications scientifiques en libre accès, liées aux projets financés par la FRM