Dans quelle mesure l’environnement influence-t-il le risque d’endométriose ?


L’endométriose est une pathologie méconnue qui touche beaucoup de femmes : 1,5 millions de femmes en France ! La prise en charge de la pathologie repose sur des traitements hormonaux, une chirurgie est pratiquée lorsque les symptômes sont trop importants.
Les chercheurs se mobilisent pour mieux comprendre les origines de la maladie et pour développer des traitements adaptés.
L’endométriose est une pathologie chronique fréquente. Selon l’Organisation mondiale de la Santé, l’endométriose concernerait environ 10 % des femmes en âge de procréer dans le monde, et 1,5 million de personnes en France. Autre chiffre impressionnant souligné par le ministère de la Santé : le retard diagnostique lié à la maladie serait de 7 ans. 30 à 40 % des femmes avec une endométriose présentent des troubles de la fertilité. Des données qui montrent l’importance de la pathologie dans la population et les problèmes de santé publique qu’elle peut poser.
L’endométriose se définit par la présence de fragments d’endomètre, la muqueuse interne de l’utérus, en dehors même de cet organe. On distingue différentes formes de la maladie selon la localisation de ces lésions (péritoine, ovaires, rectum, intestin…). La présence de ces cellules de l’endomètre hors de leur tissu d’origine pose un véritable problème. A l’instar de leur tissu d’origine, ces cellules réagissent aux variations hormonales liées aux cycles menstruels, principalement aux taux d’œstrogènes.
Les origines de la maladie sont mal connues. On a longtemps incriminé les menstruations rétrogrades, c’est-à-dire du sang qui, durant les règles, atteint la cavité péritonéale via les trompes utérines. Mais ce phénomène existe chez 90 % des femmes alors que seulement 10 % souffrent d’endométriose ! Des recherches sont ainsi menées afin de découvrir les phénomènes en jeu.
Le principal symptôme de l’endométriose est la douleur au niveau du pelvis. Elle est le plus souvent corrélée au cycle menstruel (plus forte durant les règles) mais se manifeste parfois de manière continue. Certaines femmes peuvent également ressentir des douleurs lors des rapports sexuels, lors de la défécation ou de la miction, majoritairement en période de règles. La maladie peut évoluer : la douleur est souvent plus importante au fur et à mesure du temps. D’autres signes plus discrets peuvent également être liés à l’endométriose, comme la présence de sang dans les urines ou les fèces.
L’endométriose est également vectrice d’infertilité, notamment lorsque le tissu de l’endomètre engendre des dysfonctionnements voire un blocage des ovaires.
Enfin, il est à noter que certaines formes d’endométriose ne sont pas symptomatiques et ne sont découvertes que lors d’un bilan d’infertilité.
La pathologie peut ainsi avoir des retentissements très larges sur la santé. Ainsi, pour certains chercheurs, l’endométriose n’est pas une maladie gynécologique mais une maladie chronique systémique avec une expression gynécologique forte, avec des répercussions sur l’ensemble santé physique et mentale.
Le diagnostic repose sur un interrogatoire clinique bien mené, qui s’intéresse aux douleurs de façon globale, leurs liens avec le cycle menstruel, et l’ensemble des répercussions sur la vie quotidienne…
En deuxième intention, lorsque les médecins pensent que les lésions sont plus profondes ou lorsque le diagnostic est incertain, ils peuvent avoir recours à l’échographie endovaginale ou à l’imagerie par résonnance magnétique (IRM).
Enfin, récemment, un test salivaire a été mis au point pour dépister la maladie, l’Endotest. Il s’agit d’un examen réalisé par autoprélèvement qui permet de mettre en évidence certains biomarqueurs de la maladie. Ce test est particulièrement adapté lorsque l’examen clinique et l’imagerie sont discordants. La Haute Autorité de Santé vient d’émettre un avis favorable à son remboursement dans le cadre du forfait innovation : cela permet à quelques patientes d’avoir accès à ce test tout en poursuivant les recherches visant à confirmer son intérêt médical et économique.
Plusieurs facteurs de risque avérés ont été mis en évidence dans l’endométriose : un petit poids de naissance, un indice de masse corporelle (IMC) faible dès l’enfance et jusqu’à l’âge adulte, ainsi que des menstruations précoces et des cycles courts (moins de 24 jours).
Il s’ajoute également des facteurs génétiques : leur part dans la survenue d’une endométriose a été évaluée à 50 %, sans qu’aucun « gène de l’endométriose » n’ait été identifié. Il s’agirait plutôt d’une combinaison de plusieurs facteurs génétiques. Leur caractérisation pourrait permettre de diagnostiquer précocement la maladie et donc d’accélérer sa prise en charge.
Actuellement, la prise en charge de l’endométriose repose sur trois techniques, utilisées en fonction des symptômes mais aussi des désirs de grossesse de chaque patiente.
Tout d’abord les traitements hormonaux, qui visent principalement à réduire l’impact des cycles menstruels sur les symptômes de la maladie. Plusieurs types de contraceptifs peuvent ainsi être prescrits : oestroprogestatifs, microprogestatifs oraux… D’autres médicaments peuvent être utilisés en compléments, comme des antalgiques pour limiter les douleurs (anti-inflammatoires non stéroïdiens…).
En cas de douleurs trop importantes et d’inefficacité des traitements hormonaux, la chirurgie peut être envisagée. Le geste varie selon la région dans laquelle les lésions sont situées. Il consiste à retirer les zones dans lesquelles se sont logées les cellules de l’endomètre.
Enfin, en cas de désir de grossesse et face à une infertilité, une assistance médicale à la procréation peut être proposée. Cette prise en charge passe notamment par la stimulation ovarienne (lors d’une endométriose légère à modérée) ou par la fécondation in vitro (lors d’une endométriose plus importante).
La recherche sur l’endométriose est très active. Les études portent notamment sur les causes de la maladie, son évolution et les facteurs qui l’influencent.
Des recherches portent sur les facteurs de risque génétiques de développer une endométriose. Découvrir et identifier une combinaison de plusieurs facteurs génétiques et épigénétiques (des changements dans l’activité des gènes peuvent s’opérer sans que l’ADN ne soit modifié), pourrait permettre de diagnostiquer précocement la maladie et donc d’accélérer sa prise en charge. Identifier des gènes impliqués dans la maladie peut également déboucher sur la mise en évidence de cibles thérapeutiques potentielles.
Du côté des causes, aujourd’hui, différentes pistes sont explorées comme celle du microbiote intestinal, qui serait capable de moduler les taux d’œstrogènes. D’autres équipes s’intéressent au contexte immunologique et tentent de comprendre pourquoi les cellules immunitaires ne bloquent pas l’implantation d’endomètre en dehors de l’utérus, ou comment se met en place l’inflammation chronique, caractéristique de la maladie. Enfin, une autre piste explorée concerne le lien avec une exposition aux perturbateurs endocriniens, les substances présentes dans l’environnement qui interagissent avec le système hormonal et produisent des effets néfastes sur l’organisme et/ou sa descendance.
Des avancées sont également attendues dans la réalisation du diagnostic de la maladie, notamment du point de vue de l’imagerie afin d’éviter des biopsies trop invasives. Des investigations sur des biomarqueurs sont aussi en cours, afin de faire un diagnostic plus rapide et plus fiable.
Pour la prise en charge des douleurs, des études cliniques sont en cours pour préciser l’intérêt de la neurostimulation transcutanée (TENS), une approche de court-circuitage du message douloureux par la délivrance cutanée de faibles décharges électriques. Elle a déjà fait ses preuves contre certaines douleurs chroniques.
L’amélioration des techniques chirurgicales est également un sujet d’étude exploré par les chercheurs. L’utilisation des robots est ainsi testée en vue d’améliorer la prise en charge et la qualité de vie ultérieure des patientes.
Enfin, l’endométriose pourrait également entraîner des répercussions sur la grossesse (augmentation du risque de fausses-couches, de retard de croissance du fœtus…) : la recherche se penche donc sur ces retombées néfastes éventuelles en vue d’améliorer la prise en charge des patientes.
Newsletter
Restez informé(e) !
Abonnez-vous pour recevoir les actualités et communications de la FRM, les projets et découvertes sur toutes les maladies…
Avec la FRM, chacun de vos dons est source de progrès médicaux
Soutenez les projets de recherche les plus prometteurs
Dans quelle mesure l’environnement influence-t-il le risque d’endométriose ?


Endométriose : la signature de polluants persistants ?
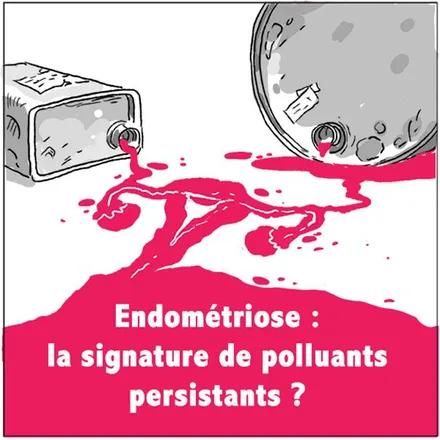
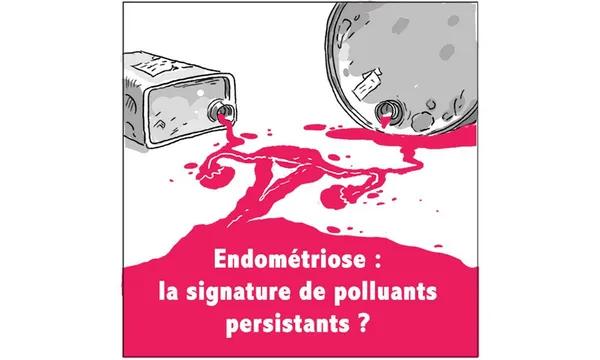
Endométriose : un impact possible des hormones thyroïdiennes


Autres maladies
