Rectocolite hémorragique : une meilleure caractérisation des lymphocytes B lors de la pathologie
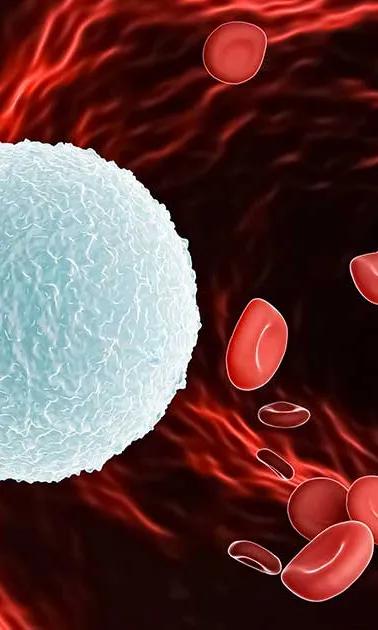
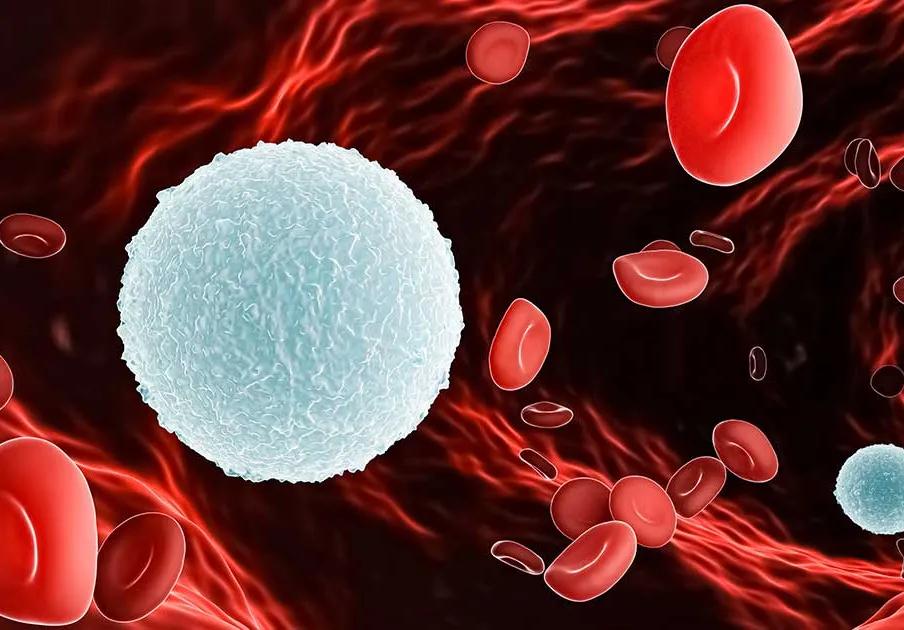
Les maladies inflammatoires chroniques de l’intestin (MICI), dont les principales sont la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique, affectent plus de 300 000 personnes en France. Ces pathologies provoquent habituellement des inflammations digestives, alternant poussées et rémissions, avec des symptômes variés tels que des douleurs abdominales, des diarrhées et des complications extra-digestives. Le traitement de ces maladies fait appel à des anti-inflammatoires, à des immunosuppresseurs, à des biothérapies, et dans les cas les plus graves, à de la chirurgie.
La recherche explore de nouvelles thérapies ciblées et le rôle du microbiote pour améliorer la prise en charge des patients.
En 2022, 303 800 français faisaient l’objet d’un suivi pour une maladie inflammatoire chronique de l’intestin (MICI) selon l’Assurance maladie. Le pic d’incidence se situe entre 20 et 30 ans, mais d’après l’Inserm, 15 % des MICI débutent chez les enfants.
Toujours selon l’Inserm, environ 60 % des MICI sont des maladies de Crohn et 40 % sont des rectocolites hémorragiques. Les MICI sont associées à un risque accru de cancer colorectal. Celui-ci est multiplié par 2 à 2,5 après 10 ans d’évolution de la maladie et jusqu’à 5 après 30 ans d’évolution.
D’un point de vue démographique, les MICI sont plus fréquentes dans les pays industrialisés, probablement à cause du mode de vie de la population, mais elles ont aujourd’hui tendance à apparaître également dans les pays en développement.
Les deux principales maladies inflammatoires chroniques de l’intestin (MICI) sont la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique, aussi appelée colite ulcéreuse. Ces maladies se caractérisent par des lésions provoquant une inflammation chronique de la paroi digestive.
Dans la maladie de Crohn, n’importe quel segment du tube digestif, de la bouche à l’anus, peut être touché. Les lésions sont profondes, mais le plus souvent cantonnées à la partie terminale de l’intestin grêle et du côlon, le gros intestin. En ce qui concerne la rectocolite hémorragique, les lésions sont plus superficielles et l’atteinte porte essentiellement sur le rectum et le côlon.
Les MICI provoquent des phases d’inflammation d’intensité variable, appelées « poussées », alternées avec des périodes de pause, dites « rémissions ». L’origine de ces affections reste mal connue. D’un point de vue physiologique, une hypothèse stipule que ces pathologies pourraient être dues à une réponse anormale des défenses immunitaires de l’intestin vis-à-vis de la flore bactérienne chez des individus génétiquement prédisposés.
Les symptômes de la maladie de Crohn diffèrent selon la localisation des lésions. Ainsi, des douleurs abdominales, des diarrhées avec ou sans émission de sang et des atteintes de la région anale, par exemple des fissures et des abcès, peuvent se manifester. Une altération de l’état général accompagne souvent les poussées, avec des fatigues, un manque d’appétit, un amaigrissement ou de la fièvre.
Les lésions inflammatoires associées à la maladie peuvent aussi conduire à un rétrécissement de l’intestin (sténose digestive) à l’origine d’occlusions. Des perforations de l’intestin peuvent survenir dans de rares cas. Il peut également y avoir des symptômes extradigestifs, notamment articulaires (arthrites), cutanés (psoriasis) ou oculaires (uvéites).
Les lésions associées à la rectocolite hémorragique provoquent, comme le nom de la maladie l’indique, des hémorragies, qui se traduisent par la présence de sang dans les selles, mais aussi des douleurs abdominales et rectales. À l’instar de la maladie de Crohn, la colite ulcéreuse peut faire l’objet de manifestations non digestives au niveau des articulations, de la peau ou des yeux.
Plus de 170 gènes de susceptibilité sont associés aux maladies inflammatoires chroniques de l’intestin. Ces gènes favoriseraient l’apparition de la maladie de Crohn, de la rectocolite hémorragique, ou des deux pathologies. Celles-ci ne sont pas pour autant des maladies héréditaires. Le gène NOD2/CARD15 attire beaucoup l’attention des chercheurs, car posséder une variante de celui-ci engendrerait un risque 40 fois plus élevé de développer la maladie de Crohn.
Les chercheurs ont montré que le tabac a un effet sur le développement des maladies inflammatoires chroniques de l’intestin. Il augmente les risques de la maladie de Crohn, mais aussi la sévérité des poussées inflammatoires. À l’inverse, le tabac est associé à un risque et une sévérité plus faibles de rectocolite hémorragique, bien qu’aucun traitement à base de nicotine n’ait donné de résultats positifs dans cette pathologie.
La part des facteurs environnementaux reste pour le moment encore un peu floue. L’alimentation pourrait être impliquée dans le développement des maladies inflammatoires chroniques de l’intestin, notamment par le biais d’une perturbation du microbiote intestinal, augmentant l’inflammation. Ce lien entre dysbiose intestinale et MICI pourrait avoir des origines infectieuses ou médicamenteuses liées à la surconsommation d’antibiotiques. La pollution aux métaux lourds et aux nanoparticules est aussi suspectée de jouer un rôle dans le développement des MICI, mais cela n’a pas été clairement démontré. Enfin, l’ablation précoce de l’appendice, avant 20 ans, semble protéger de la rectocolite hémorragique, ce qui suggère une implication de cet organe dans le développement de la maladie.
Le diagnostic des MICI repose sur un faisceau d’arguments cliniques. Face aux premiers symptômes, le praticien peut prescrire dans un premier temps une analyse de sang. Celle-ci peut révéler un état inflammatoire caractérisé par une augmentation de la protéine C-réactive (CRP), une carence nutritionnelle concernant des vitamines essentielles, ou la présence de marqueurs de pathologies inflammatoires intestinales chroniques comme les anticorps ASCA et ANCA.
Les selles du patient peuvent également être étudiées pour rechercher la calprotectine, une protéine présente en cas d’inflammation sévère de l’intestin. Elle n’est pas spécifique aux MICI, mais permet d’écarter d’autres pathologies. La mesure de cette protéine est aussi utilisée pour le suivi des maladies inflammatoires chroniques de l’intestin.
La coloscopie est la technique de choix pour compléter les différentes analyses biologiques. Pratiquée sous anesthésie générale, elle consiste à introduire par l’anus un tube fin et souple muni d’un système optique. Elle offre une visualisation directe de la paroi intestinale, permettant à la fois de dépister des lésions et d’effectuer des prélèvements. Une variante de la coloscopie, l’iléocoloscopie, réside dans la visualisation du rectum, du côlon et d’une partie de l’intestin grêle.
D’autres examens d’imagerie comme la radiographie, l’échographie, le scanner ou l’imagerie par résonnance magnétique (IRM), peuvent être pratiqués pour diagnostiquer une maladie inflammatoire chronique de l’intestin. Dans certains cas, un examen par vidéocapsule peut être envisagé pour visualiser l’état de l’intestin grêle. Il consiste en l’ingestion d’une petite capsule à usage unique contenant une source lumineuse et une caméra miniature. Les images enregistrées par des capteurs tout au long du transit sont ensuite interprétées par le médecin.
Les poussées inflammatoires sont traitées de manière similaire à d’autres maladies inflammatoires chroniques avec des molécules anti-inflammatoires plus ou moins puissantes, comme les 5-aminosalicylés ou les corticoïdes. L’utilisation au long cours d’immunosuppresseurs, comme la cyclosporine, l’azathioprine ou le méthotrexate, est aussi une option.
Le traitement des MICI bénéficie également des avancées de la recherche dans le domaine des biothérapies. Si les médicaments ne sont pas efficaces ou si un traitement de fond est nécessaire, les médecins optent pour un immunomodulateur, par exemple l’infliximab ou l’adalimumab, qui sont des anticorps monoclonaux anti-TNF. Ces composés freinent les défenses immunitaires, ce qui a pour effet de diminuer l’inflammation. D’autres immunomodulateurs sont utilisés dans les MICI, comme l’ustekinumab ou le vedolizumab. Ces traitements pouvant perdre en efficacité avec le temps, il peut être nécessaire de changer de molécule.
En parallèle des traitements visant l’inflammation associée aux MICI, des anti-diarrhéiques et des compléments alimentaires peuvent être prescrits aux patients pour traiter les symptômes tels que les diarrhées ou les carences en vitamines.
En cas de complication, ou lorsque la maladie ne répond plus aux traitements, une intervention chirurgicale devient parfois nécessaire pour supprimer la partie de l’intestin atteinte, en particulier le côlon ou le rectum. Selon l’Inserm, la chirurgie concerne actuellement 1 patient sur 2 après 10 ans d’évolution de la maladie.
La recherche s’intéresse aux facteurs de risque et aux facteurs protecteurs qui entrent en jeu dans les maladies inflammatoires chroniques de l’intestin, afin de mettre en place des actions de prévention. Elle étudie notamment l’appendicectomie, qui est un facteur protecteur de la rectocolite hémorragique, mais qui paradoxalement, augmente le risque de cancer colorectal. Des chercheurs se penchent aussi sur une population de cellules stromales responsables du bon développement de l’intestin après la naissance. Préserver ces cellules et leur bon fonctionnement serait une clé pour prévenir les maladies inflammatoires de l’intestin.
Côté dépistage, des scientifiques sont récemment parvenus à mettre au point un test sanguin basé sur l’analyse d’une combinaison de protéines, permettant de détecter les MICI jusqu’à 16 ans avant le diagnostic.
Des recherches menées dans le domaine de la génétique améliorent la compréhension des voies immunitaires impliquées dans les MICI. Plusieurs acteurs au rôle essentiel ont été mis au jour. Pour exemple, on peut citer la protéine AGR2, qui participe à la mise en place de l’inflammation dans la maladie de Crohn, l’interféron lambda, qui empêche l’intestin de se réparer après une lésion, ou encore l’hormone hepcidine, la protéine HP1 et la protéine élafine, qui agissent contre l’inflammation.
Dans les MICI, le phénomène d’inflammation se répercute sur plusieurs cellules immunitaires, en particulier les lymphocytes B et les lymphocytes T. Une meilleure caractérisation des mécanismes en jeu au niveau de ces cellules pourrait permettre de les cibler spécifiquement dans de nouvelles stratégies thérapeutiques. En ce sens, des molécules anti-inflammatoires et immunomodulatrices entrent régulièrement en phase d’essai clinique.
Des liens étroits ont été retrouvés entre le déséquilibre du microbiote intestinal, appelé dysbiose, et le développement de maladies inflammatoires intestinales chroniques, notamment sous l’influence d’additifs, d’émulsifiants alimentaires, ou de microplastiques. La recherche s’attache à éclairer l’impact du rétablissement d’une flore intestinale normale, ou de sa modulation chez les patients atteints de MICI.
L’utilisation de probiotiques administrés par voie orale est une autre approche visant à rééquilibrer le microbiote intestinal anormal, mais elle n’offre pour l’instant pas de résultats réellement concluants. En revanche, la transplantation fécale d’une flore bactérienne saine chez des malades s’est déjà montrée bénéfique pour la prise en charge de patients atteints de rectocolite hémorragique, encourageant la poursuite de ces recherches. La piste d’un vaccin ouvre quant à elle l’opportunité de cibler les mauvaises bactéries du microbiote, responsables d’une augmentation de l’inflammation.
Newsletter
Restez informé(e) !
Abonnez-vous pour recevoir les actualités et communications de la FRM, les projets et découvertes sur toutes les maladies…
Avec la FRM, votre don est un espoir de guérison
Soutenez les projets de recherche les plus prometteurs.
Maladies rares

Rectocolite hémorragique : une meilleure caractérisation des lymphocytes B lors de la pathologie
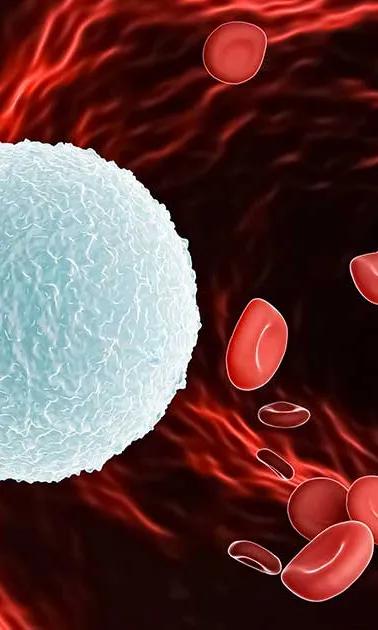
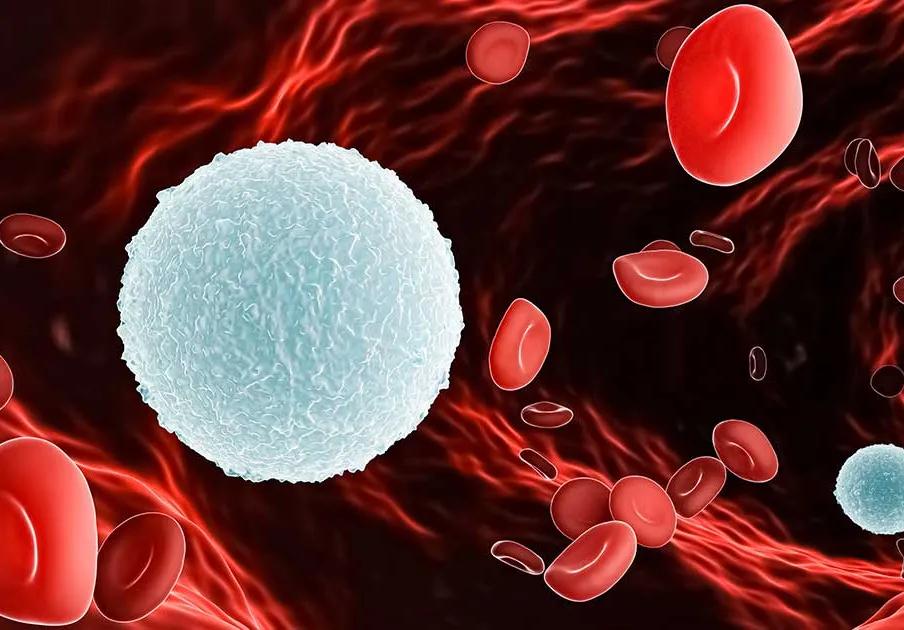
MICI : moduler l’action du microbiote pour réduire l’inflammation intestinale
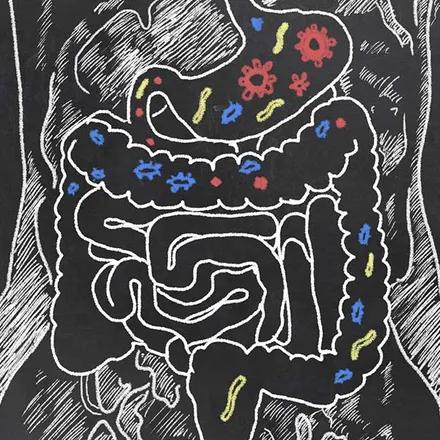
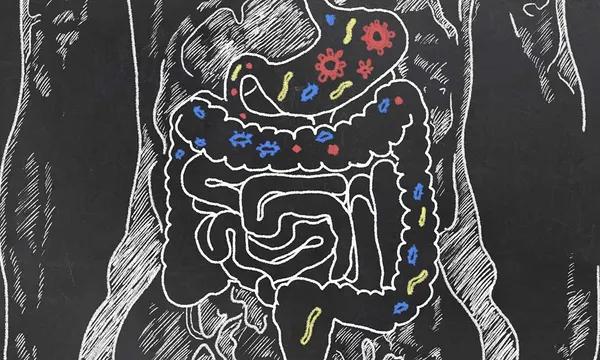
MICI : une meilleure compréhension des mécanismes prédisposant à ces pathologies

